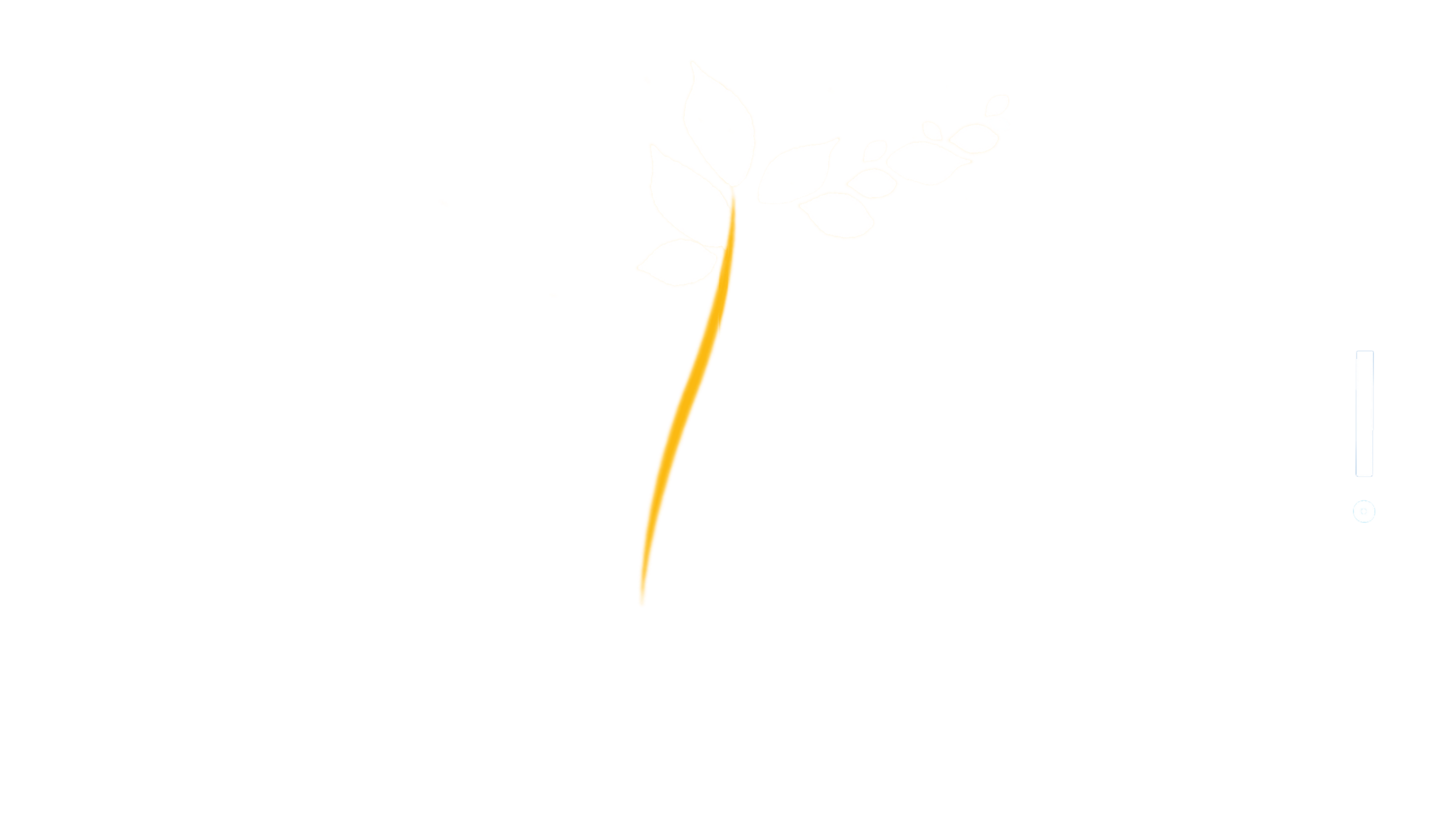AVANCEES MEDICALES. Dans le second épisode du podcast Inspirons !, le Pr Barbara Seitz-Polski (CHU de Nice) revient sur l’utilité des données de la qualité de l’air d’AtmoSud pour faire avancer ses recherches sur le système immunitaire et les maladies virales et auto-immunes. Loin d’être un champ d’application unique, les données recueillies par notre observatoire servent de nombreuses recherches médicales. Présentation.
Pollution à l’ozone : un impact avéré dans l’infarctus du myocarde

Dans le cadre d’une étude rétrospective menée sur huit ans (2010–2018), les capteurs de la pollution de l’air d’AtmoSud ont permis au Professeur émérite UCA Pierre Gibelin, cardiologue au CHU de Nice, d’évaluer l’impact des pics de pollution par l’ozone sur les arrêts cardiaques hors hôpital dans la région niçoise. Une étude attendue quand 70 à 80% des décès dus à la pollution sont d’origine cardiovasculaire.
Portant sur 557 infarctus du myocarde survenus chez des sujets âgés de 68,2 ans en moyenne pour les hommes, et de 75,1 ans pour les femmes, l’étude a permis d’établir un risque accru d’arrêts cardiaques lorsque les sujets sont exposés de façon brève, et quelle que soit la saison, à un niveau élevé d’ozone dans l’air. Elle a par ailleurs montré que les particules fines n’avaient pas d’impact réel sur l’infarctus du myocarde.
Particules fines et dioxyde d’azote incriminés dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë
En 2020, une étude rétrospective pour évaluer l’incidence du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) en fonction de l’exposition aux polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote et ozone) en région Sud a été menée par Laëtitia Gutman et son équipe. En s’appuyant sur les données 2016-2018 de l’INSEE, de la base PMSI des structures hospitalières (4 733 patients touchés par un SDRA en région Sud), et les informations produites par AtmoSud, celle qui était alors interne en médecine intensive-réanimation à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a mis à jour une corrélation statistiquement significative entre une exposition à long terme (1, 2 et 3 ans) aux particules fines (PM2.5, PM10) et au dioxyde d’azote (NO2), et une augmentation de l’incidence et de la mortalité du SDRA.
Particulièrement aux abords des trois métropoles du territoires (Marseille-étang de Berre, Presqu’île de Giens-Toulon et Nice). Pour rappel, le SDRA est une maladie qui touche environ 10% des patients hospitalisés en réanimation et dont on estime qu’elle représente 40 à 50% des décès hospitaliers.
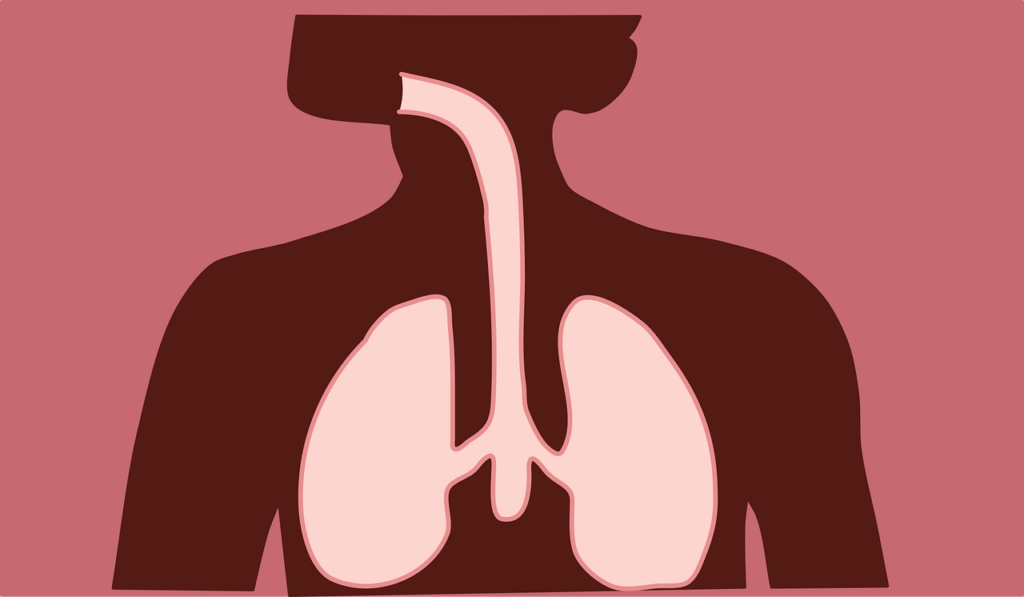
Incidence faible entre pollution et symptômes de la rhinite allergique

Dans le cadre d’une collaboration entre l’organisation de coopération et de développement économiques pour les maladies chroniques MASK@PACA et AtmoSud, une étude clinique a été menée en 2020 sur le territoire de l’étang de Berre, zone fortement industrialisée des Bouches-du-Rhône. Dans cette partie du territoire où la fréquence de l’asthme est élevée, l’objet était d’explorer le lien complexe entre l’exposition à la pollution et aux allergènes, au travers de l’impact des polluants sur les symptômes associés à la rhinite allergique.
Grâce à l’application MASK-air, où ont été intégrées simultanément les données d’AtmoSud sur la qualité de l’air, et celles du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) sur les pollens, il est possible d’analyser l’évolution de ces symptômes au quotidien en fonction de la pollution. L’étude a permis de faire état d’une faible incidence des polluants étudiés sur les symptômes de la rhinite allergique, ce qui confirme une autre étude, POLLAR (Impact of Air Pollution on Asthma and Rhinitis, EIT Health, Europe du Nord) : l’ozone augmente faiblement les symptômes, les particules fines (PM2.5) n’ont aucun effet sur eux, et le dioxyde d’azote (NO2) les réduit faiblement. Toutefois, si les polluants du l’air n’ont qu’un faible impact sur les symptômes de la rhinite allergique, ils n’en demeurent pas moins qu’ils diminuent les seuils d’allergie aux pollens.
Lien suspecté entre pollution atmosphérique et « poussées » rhumatismales
Quand le rôle des facteurs environnementaux (tabac, bactéries, silice…) est démontré dans le cas des maladies rhumatismales de type polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante et de rhumatisme psoriasique, le Professeur Christian Roux, PUPH de rhumatologie, coordinateur du centre de recherche du CHU de Nice, s’interroge sur le rôle des polluants atmosphériques dans le cas des poussées inflammatoires de la maladie. Entouré de ses équipes, il mène actuellement une étude pour observer les épisodes chroniques inflammatoires de ses patients, depuis leur domicile ou leur lieu de travail, en les croisant avec les données collectées par des capteurs AtmoSud pour évaluer la qualité de l’air.
Cette étude prospective a pour but de qualifier le lien entre les pics de pollution aux particules fines, au dioxyde d’azote et à l’ozone, et les poussées inflammatoires rhumatismales de ses patients.

Rôle de la pollution de l’air dans les cancers

Mis en place dans le cadre de l’appel à projets CANC’AIR de la Fondation ARC, OCAPOL est le premier observatoire national des liens entre la pollution de l’air et le cancer. Déployé dans l’hexagone par le biais de deux larges cohortes, Gazel et Constances, soit plus de 200 000 individus répartis dans les différentes régions de France, son rôle est de déterminer l’impact à long terme des différents polluants atmosphérique sur la survenue de cancers chez l’adulte.
Cette étude épidémiologique de grande ampleur est menée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), qui s’est appuyé sur différentes AASQA régionales, dont AtmoSud, pour fournir des données harmonisées sur la qualité de l’air pour la période 2008-2016. Le but est également de permettre des évaluations et des modélisations suite aux expositions des individus des deux cohortes. Finalisé en 2022, OCAPOL est à présent un outil pérenne utile au pilotage des politiques de santé publique, qui a notamment servi à l’élaboration du troisième Plan Cancer.

Des données sur l’air
au service de la santé unique
Comme l’enseignent ces différentes recherches, la qualité de l’air est un facteur déterminant dans l’approche de nombreuses pathologies et maladies. En tant qu’Observatoire référent Air-Climat-Energie en Provence-Alpes-Côte d’Azur, AtmoSud est le partenaire d’un nombre toujours plus important d’études et de recherches menés au sein d’établissements de santé du territoire (hôpitaux, cliniques, laboratoires…). Nos équipes d’ingénieurs et de scientifiques restent à l’écoute de tout projet permettant des avancées dans le secteur de la santé publique et environnementale. N’hésitez pas à nous contacter.
Trois questions à…
Professeur Pierre Gibelin
Cardiologue au CHU de Nice

Depuis l’étude que vous avez menée pour mettre à jour le lien entre pollution à l’ozone et infarctus du myocarde, poursuivez-vous vos recherches dans ce sens ?
Après cette étude rétrospective, nous en avons réalisé une autre à l’échelle régionale. Elle porte sur la période 2013-2023 et nous nous sommes encore basé sur les données de la qualité de l’air d’AtmoSud et d’autres mesures obtenues par satellite. Cette étude s’intéresse au lien entre la pollution de l’air et l’insuffisance cardiaque aiguë, particulièrement aux cas d’œdèmes aigus du poumon qui peuvent en résulter. Nous nous sommes intéressés aux 40 000 cas survenus sur la période et à leur exposition aux particules fines PM10 et PM2,5, au dioxyde d’azote (NO2) et à l’ozone (O3). Comme la région Sud offre une typologie territoriale très disparate, entre les grandes villes, les zones plus rurales, les bords de mer, les axes routiers… nous l’avons découpée en clusters.
Les maladies cardiovasculaires représentent de 70 à 80% des décès dus à la pollution.
Le lien est-il avéré pour tous les polluants observés ?
Oui, même s’il existe bien entendu une hiérarchie en fonction des clusters, où certains polluants sont plus présents que d’autres. Comme le NO2 aux abords des autoroutes, les particules fines PM10 dans la zone industrielle de l’étang de Berre, où les particules PM2,5 dans les grandes villes. On peut retrouver les PM2,5 en quantité importante dans différentes zones du territoire, sans qu’elles aient pour autant la même origine. Par exemple, sur le pourtour de l’étang de Berre, où elles proviennent massivement de l’activité industrielle. Ou dans les zones plus rurales, où leur présence est majoritairement due aux feux de forêt et au chauffage au bois. Ce qui leur donne aussi une composition différente. Bien que leur proportion reste faible, la question de leur impact sur la santé subsiste, car contrairement à l’ozone, on ne connaît pas le seuil à partir duquel elles affectent la santé. L’OMS mentionne un seuil de 5 μg/m³, mais en réalité, on ne sait pas.
Quels sont vos prochains sujets d’étude ?
Nous sommes entrain de mettre en place une étude pour évaluer la température optimale à Nice. Soit, la température à laquelle on enregistre le moins d’hospitalisations en lien avec la pollution, en particulier dans le cas de maladies cardiovasculaires. A noter que le terme cardiovasculaire se rapporte à l’organe du cœur mais aussi du cerveau. Contrairement aux idées reçues, ce type de maladies représente de 70 à 80% des décès dus à la pollution. On sait que les pics de pollution à l’ozone sont plus importants lors des périodes de canicules et qu’ils peuvent multiplier le risque. L’idée est donc de voir quel est l’impact de l’ozone dans la survenue des infarctus et des autres maladies cardiovasculaires en fonction des différents degrés de température l’été : à 30°C, 31°C, 32°C, etc.