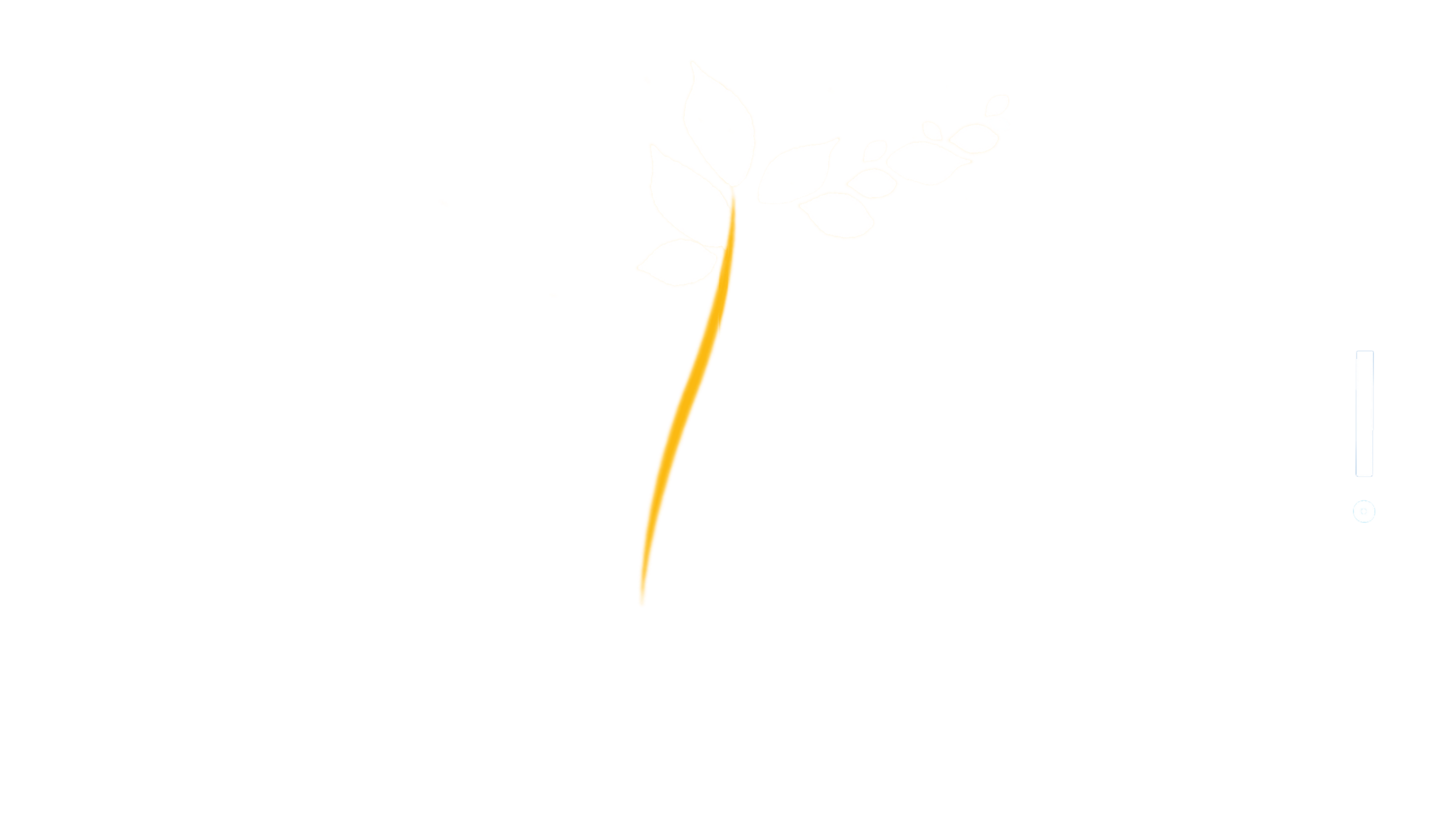Réhabilitation urbaine. La seconde phase d’aménagement du plus grand projet de réhabilitation urbaine d’Europe, vouée à transformer le nord de Marseille en un écoquartier mixte « à haut niveau de services », fait de la lutte contre les îlots de chaleur urbains (ICU) une priorité. Les explications de Brice Chandon, responsable ingénierie du développement durable au sein d’Euroméditerranée.
Quels nouveaux contours entend donner Euromed II à l’espace public dans le nord de Marseille ?
Brice Chandon : Dans les grands aménagements que nous réalisons, nous priorisons d’abord la réduction de la place de la voiture dans les espaces publics. La volonté est de créer davantage de rues piétonnes et avec elles, d’augmenter l’aménagement d’espaces verts. A ce titre, nous prenons toujours plus en compte les sols dans toutes leurs dimensions. On désimperméabilise les sols anciennement occupés par d’ancienne friches industrielles. Sur les espaces habillés de revêtements minéraux, on essaie d’opter pour un maximum de matériaux drainants. Le sol redevient un support d’infiltration qui comporte une dimension vivante. La but est de retrouver un fonctionnement du sol en ville qui permette aux végétaux et à la biodiversité de se développer de manière pérenne. Tout en offrant un meilleur confort de vie aux habitants.
C’est ce que vous avez initié dans l’espace public des Fabriques, près du métro Gèze dans le 15ème arrondissement ?
B.C. : Le projet de l’espace public des Fabriques est encore dans sa première phase. Des rues piétonnes ont effectivement été réalisées. Un petit square provisoire a été créé pour témoigner de la volonté d’inclure la végétation en ville. Quelques corps de rues montrent aussi des aménagements paysagers. Là où les voitures sont écartées, la majorité des revêtements de sol sont aujourd’hui drainants. Dès le début des aménagements dans cette partie nord-ouest d’Euromed II, l’idée d’infiltrer les eaux pluviales et de fertiliser les sols était présente. Mais les acteurs engagés dans ces démarches étaient encore peu nombreux par rapport à aujourd’hui. On a donc créé un jardin d’expérimentation en 2020 pour faire le lien avec les gestionnaires de l’espace public et les entreprises. Et lever les freins que rencontrent ces démarches d’économie circulaire.

Avez-vous pu mesurer l’impact de ces actions sur le phénomène d’îlots de chaleur urbains et la qualité de l’air ?
B.C. : C’est difficile de rendre compte de l’impact des actions menées, y compris sur la qualité de l’air. Avant le lancement des aménagements urbains, les grandes friches industrielles définissaient la physiologie du quartier. Depuis les aménagements, ce sont des immeubles et des espaces publics. Comparer les situations est compliqué. Mais suite à l’évaluation de l’impact potentiel de certains projets d’aménagement d’Euroméditerranée sur le climat réalisée par Météo France en 2013, certaines actions semblent avoir un effet positif sur la formation des ICU. On peut citer le futur grand parc urbain du ruisseau des Aygalades, conçu comme un élément central de lutte contre les ICU. Les modélisations de Météo France ont permis d’établir que ses aménagements assureront un confort thermique important, marqué notamment par une réduction des températures nocturnes. Dans le parc lui-même, mais aussi dans l’environnement immédiat.
Toutes les solutions testées pour réduire l’impact de la chaleur et des ICU se sont-elles révélées positives ?
B.C. : Pas toutes non. Par exemple, nous avons choisi des revêtements de surfaces clairs, pour avoir un albédo élevé qui réfléchit les rayons du soleil. On a constaté que cela n’a pas que des impacts positifs. Si les sols n’absorbent effectivement pas les rayons, ils peuvent aussi être piégés et être réfléchis vers les piétons. Le réseau thalasso thermique de production de froid et de chaud mis en place, notamment sur le quartier des Fabriques, a montré de son côté une incidence fortement positive sur les ICU. Contrairement aux dispositifs de climatisation, utiliser l’inertie thermique de la mer comme système de rafraîchissement n’aggrave pas la formation des îlots de chaleur urbains. En parallèle, nous portons aussi des critères de qualité liés à l’architecture bioclimatique. Par exemple, la création d’appartements traversants qui offrent une ventilation naturelle.

Est-ce que ces aménagements tendent à s’appliquer à d’autres échelles, ailleurs que sur le périmètre d’Euroméditerranée ?
B.C. : Oui, et c’est l’un des objectifs du Laboratoire collectif d’innovation urbaine. Il a été créé pour expérimenter, à petite échelle, des solutions d’adaptation au changement climatique et en tirer des enseignements. Notamment dans les espaces publics, comme c’est le cas avec le Jardin des expérimentations des Fabriques. Le projet Euroméditerranée représente un permis d’innover sur un territoire dédié. Il permet de tester des choses en lien avec les collectivités gestionnaires, sur des thématiques précises. Ces expérimentations sont suivies, documentées et font l’objet de retours d’expérience pour ajuster ou améliorer les pratiques. L’idée, c’est que les enseignements puissent être transposés ailleurs. Sur d’autres projets à Marseille, dans des villes méditerranéennes, voire au-delà. C’est dans ce cadre qu’on a développé le Guide de conception de la ville avec le vent, qui sera présenté à la fin de l’année.
Le Guide de conception de la ville avec le vent ?
B.C. : C’est un document produit en lien avec les activités du Laboratoire collectif d’innovation urbaine. Il a été construit sur base de retours d’expérience. La volonté est d’intégrer des éléments d’architecture bioclimatique et de mieux concevoir la ville en tenant compte du vent. On y inclut aussi les résultats de l’étude menée en 2013 avec Météo France, qui ne s’est pas limitée à estimer les conditions climatiques sur Euromed II, mais sur le climat urbain alentours. Elle a démontré l’intérêt climatique des cœurs d’îlots plantés, ce qui a facilité la transcription de cette forme d’aménagement dans les projections des règles d’urbanisme locales. L’ambition de ce Guide du vent est qu’il devienne un outil prescripteur. Pour potentiellement aider d’autres territoires à se lancer dans ce type de démarches. Notamment en matière d’atténuation des îlots de chaleur urbains.
Avez-vous rencontré des freins pour généraliser ces pratiques d’adaptation au dérèglement climatique nées dans le cadre d’Euromed II ?
B.C. : La principale difficulté est liée au changement des pratiques. Bien que les idées soient pertinentes, faire évoluer les comportements génère énormément de questionnements. La facilité est souvent de continuer à faire la même chose plutôt que d’essayer autrement. Ce problème, couplé à beaucoup d’inertie lié au temps long qui est celui de l’aménagement, est le principal frein à l’innovation. Le Jardin d’expérimentation des Fabriques est en ce sens positif. Il a permis d’impliquer les différents acteurs du projet bien en amont, dans la sélection des enjeux environnementaux et d’innovation. Faire intervenir toute la chaîne de valeur en même temps permet de cumuler les contributions et d’avancer ensemble dans la bonne direction.
BON A SAVOIR : Les Fabriques, un îlot XXL
Le projet de l’îlot XXL des Fabriques consiste à opérer la mutation d’une zone urbaine et d’activités industrielles de 14 ha en un écoquartier mixte « à haut niveau de services ». Il s’inscrit dans l’Opération d’Intérêt National (OIN) Euroméditerranée, créée en 1995 sur un périmètre initial de 380 ha (Euroméditerranée I) et étendu en 2007 de 170 ha supplémentaires vers le nord (Euroméditerranée II).
L’extension du périmètre s’est accompagnée de la définition de trois axes stratégiques : l’Ecocité, les infrastructures métropolitaines et la relation ville-port. La stratégie de l’Ecocité présente Euromed II comme un laboratoire de recherche appliquée de la ville méditerranéenne durable.
En lien avec cet article

Podcast | Arbres et forêts face à la soif du climat.
Quel devenir pour nos forêts méditerranéennes ?